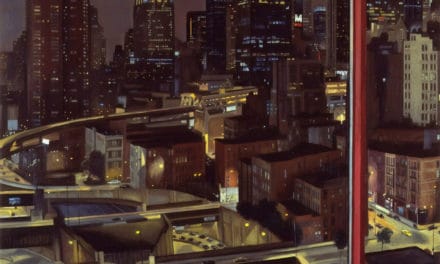Le silence qui naît du bruit de la pluie – Fernando Pessoa

98
Le silence qui naît du bruit de la pluie s’éparpille, avec un crescendo de monotonie grisâtre, dans la rue étroite que je contemple. Je dors tout éveillé, debout contre la vitre à laquelle je m’appuie, comme à toute chose. Je cherche en moi quelles sensations j’éprouve devant cette chute effilochée d’une eau obscurément lumineuse, qui se détache sur les façades sales et, plus encore, sur les fenêtres grandes ouvertes. Et je ne sais ni ce que j’éprouve, ni ce que j’ai envie d’éprouver, je ne sais ce que je pense ni ce que je suis.
Toute l’amertume à retardement de ma vie se dépouille, sous mes yeux vides de toute sensation, du costume de gaieté naturelle qu’elle revêt dans les occasions fortuites, sans cesse renouvelées, de la vie quotidienne. Je constate — moi si souvent d’humeur joyeuse, si souvent content de mon sort — que je suis toujours triste. Et celui qui, en moi, fait ce constat, se trouve en fait derrière moi, semble se pencher sur mon corps appuyé à la fenêtre, et regarder — par-dessus mon épaule ou par-dessus ma tête, avec des yeux plus intimes que les miens — la pluie lente, légèrement ondulée déjà, qui raye de sa chute en filigrane l’air sombre et mauvais.
Négliger tous ses devoirs, même ceux que personne n’exige de vous, répudier tous les foyers, même ceux que l’on n’a jamais eus, vivre de flou et de vestiges, parmi de lourdes draperies de folie pourpre et les fausses dentelles de royautés rêvées… Être quelque chose qui ne sente pas la tristesse de la pluie extérieure, ni la douleur de ce vide intime… Errer sans âme ni pensée, sensation dépouillée d’elle-même, par des routes contournant des montagnes, par des vallées encaissées entre des pentes escarpées, et passer lointain, absorbé et fatal… Se perdre dans des paysages semblables à des tableaux. Cesser d’être, dilué en lointains et en couleurs…
Un léger souffle de vent, que je ne peux sentir derrière ma fenêtre, déchire en dénivellements aériens la chute rectiligne de la pluie. Quelque part s’éclaircit un coin de ciel, que je ne vois pas. Je m’en aperçois parce que, derrière les vitres à moitié propres de la fenêtre d’en face, j’aperçois déjà vaguement, à l’intérieur, le calendrier suspendu au mur, que je ne pouvais voir jusqu’à présent.
J’oublie tout ; je demeure sans voir, et sans pensée.
La pluie cesse, et il en reste, un instant, une poussière de diamants minuscules, comme si, de là-haut, on secouait des miettes d’une grande nappe azurée. On sent qu’une partie du ciel est déjà bleue. On voit plus nettement le calendrier, à travers la fenêtre d’en face. Il représente un visage de femme, et pour le reste, c’est facile parce que je me souviens qu’il s’agit d’une pâte dentifrice archi-connue.
Mais à quoi pensais-je donc avant de me perdre ainsi à regarder ? Je ne sais… Volonté ? Effort ? Vivre ? Sous une grande percée de lumière on sent que c’est presque tout le ciel maintenant qui est bleu. Mais nulle paix — ah ! je ne la connaîtrai jamais ! — au fond de mon cœur, ce vieux puits au fond d’un jardin qu’on a vendu, souvenir d’enfance enfermé sous la poussière, dans le grenier d’une maison devenue étrangère. Nulle paix, non, mais pas davantage — hélas ! — le moindre désir de la connaître.